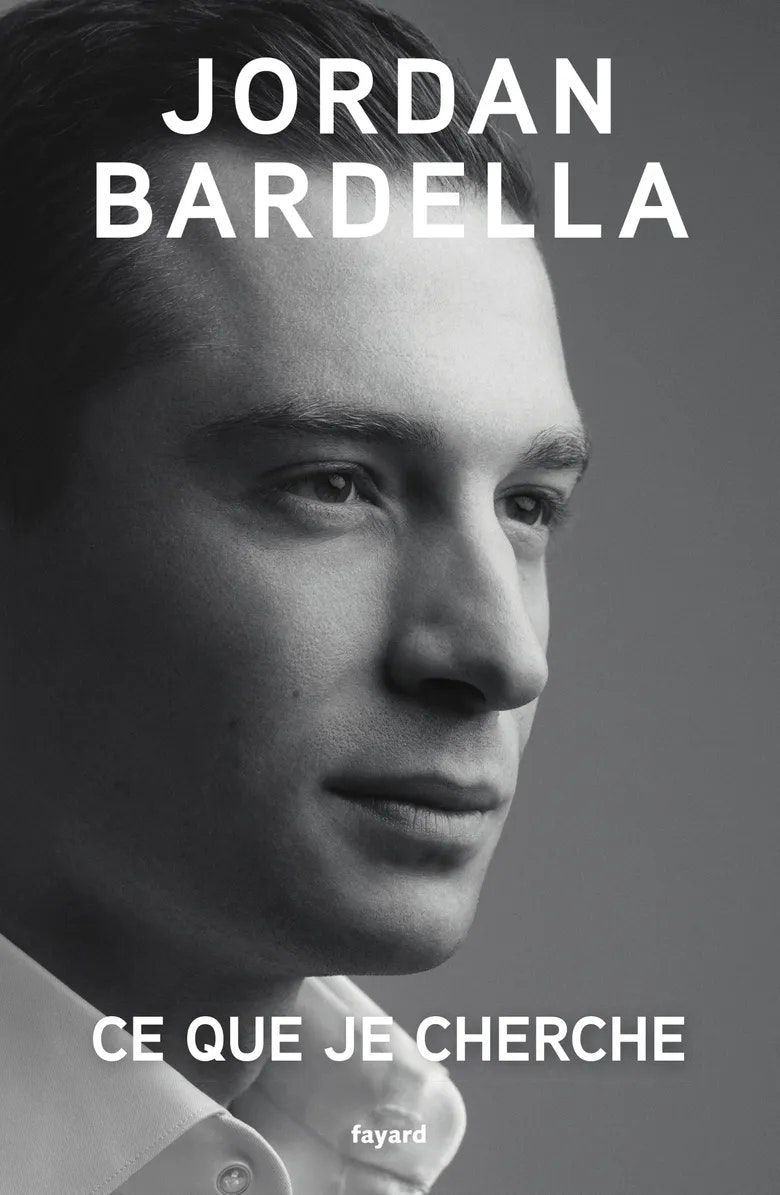Bardella : ce « je » qu’il cherche
Gilles Deleuze disait qu’un livre mérite d’exister s'il corrige une erreur répandue, répare un oubli essentiel ou forge un nouveau concept. Spoiler alert : on ne trouvera aucun nouveau concept et même aucune idée nouvelle dans ce pavé de plus de 300 pages, ce qui relève d’une sacrée performance lorsqu’on prétend renouveler la politique.
« J’entends déjà mes détracteurs, écrit Jordan Bardella, apparemment anxieux des retours au point de devancer les critiques. Ils jugeront ce livre « médiocre », « indigent » et « sans intérêt ». »
Sans intérêt, certainement pas, puisque ce livre a le mérite de corriger une erreur répandue : le costume de Premier ministre était bien trop grand pour Jordan Bardella.
À rebours de la stratégie marketing élaborée pour sa parution, censée asseoir ses ambitions nationales, Ce que je cherche contribue au contraire à donner du corps à une analyse trop peu développée : si les résultats du Rassemblement National aux dernières élections législatives ont finalement marqué un nouvel échec du RN, c’est peut-être, aussi, parce que les Français ont considéré que Jordan Bardella avait encore du chemin à parcourir avant de pouvoir prétendre s’installer à Matignon.
Des « Français oubliés » à l’oubli des Français
En principe, les livres-mémoires des politiques ont une fonction : donner à voir l’homme (ou la femme) qui se cache derrière le personnage public. Il s’agit de « fendre l’armure », et surtout de gagner en épaisseur. « Ce livre n’est ni un essai ni un programme : il est le reflet de mon existence » lit-on dans l’introduction. Mais au seuil de la trentaine, le point d’étape sonne cruellement creux : aucune passion n’est mentionnée, aucun centre d’intérêt, ni même une seule activité extrapolitique ; on ne croise aucun ami en dehors de sa garde rapprochée, on n’assiste à aucune rencontre hors du sérail ; on ne relève pas le moindre événement personnel qui s’inscrirait dans autre chose qu’un fait d’actualité ou de campagne électorale.
Même lorsque Jordan Bardella fait des karaokés, c’est encore avec sa boss, « Marine ». C’est simple : la politique a tout bouffé.
Militant depuis l’âge de 16 ans, le timide d’hier est devenu la machine de guerre médiatique que l’on connaît aujourd’hui : mais à quel prix ? « L’engagement politique est un sacerdoce, écrit-il. J’ai dû faire des choix, des concessions, des renoncements ». C’est vrai qu’à le lire, on a le sentiment que Jordan Bardella a tout bonnement oublié de vivre. Mais peut-on raisonnablement vouloir « changer la vie » lorsqu’on l’a si peu éprouvée ? Ses thuriféraires aiment à répéter que « la valeur n’attend point le nombre des années », mais le problème que ce livre rend manifeste, ce n’est pas l’âge de Jordan Bardella, c’est son absence de vécu.
À ce rythme, d’ici dix ou quinze ans, Jordan Bardella risque de devenir une sorte de chatbot politique : il aura réponse à tout, mais pas d’existence propre. On en viendrait presque à lui souhaiter au plus vite une traversée du désert, histoire qu’il puisse enfin vivre quelque chose de personnel.
Puisque sa vie se résume à sa vie politique, plongeons-y. Qu’a-t-il à en dire ? Essentiellement, une seule chose, aux antipodes de la dimension sacrificielle promise par cette idée de « sacerdoce » : pour Bardella, la politique, c’est que-du-kif. Loin de remplir sa promesse de « raconter aux Français l’envers du décor de la vie politique », ce livre décrit, dans une forme rare de naïveté très premier degré, la découverte par le jeune Bardella d’un monde politique qui, manifestement, exerce sur lui une totale fascination.
Car la politique dont il est question dans ce livre se résume à la narration d’une odyssée personnelle : on ne trouve trace d’aucune vision, d’aucune valeur, d’aucun combat qui lui tienne à cœur ; par contre, on apprend tout de ses délicieuses « montées d’adrénaline », de ses folles « nuits blanches » passées au siège du RN les soirs d’élection, de ses prises de parole dans des « salles prestigieuses », de ses stimulantes « courses contre la montre ».
Son quotidien ? Un tourbillon étourdissant : « Je cours les matinales des grandes chaînes, je vais de débats en colloques, de réunions programmatiques en rencontres thématiques et de déplacements en meetings à un rythme effréné ». Mais quel kif ! « Décidément, ma vie n’est pas ordinaire » s’extasie-t-il. Un épisode est particulièrement représentatif de ce rapport de l’auteur à la politique. En 2019, alors qu’on lui annonce qu’il sera la tête de liste RN aux élections européennes, on le prévient : « Ta vie va changer ». La phrase le marque de façon indélébile, et donne d’ailleurs son titre au chapitre 12.
Mais quelle forme prend pour Jordan Bardella cette révolution personnelle ? Quelle est la première pensée qui le traverse lorsqu’il se projette dans son nouveau statut ? Songe-t-il avec gravité à ses futures responsabilités ? Pense-t-il avec empathie aux gens dont il entend se faire le porte-voix ? Non, son premier réflexe est ailleurs : Jordan Bardella frétille à l’idée que son visage se retrouvera bientôt sur « des milliers d’affiches collées et des tracts distribués dans tout le pays ». Sur-kif.
Un mot résume finalement le rapport qu’il noue à la politique : « vertige ». Répété à dix reprises (en comptant son adjectif dérivé, « vertigineux »), il dit tout de la façon dont Bardella réduit la politique à son propre ressenti émotionnel. Comme si les batailles électorales et les expériences politiques accumulées ces dernières années par Jordan Bardella n’avaient servi qu’à remplir un « moi » en mal de contenu. Vertigineux, en effet.
Totalement égocentrique ? Oui, bien sûr. Comme beaucoup de politiques. Mais jamais à ma connaissance un responsable de son niveau, le président du premier parti d’opposition, n’avait raconté son expérience politique avec un tel narcissisme et, corrélativement, une telle étroitesse d’esprit. Ce qui transpire dans ces lignes, et que le grand public n’avait sans doute pas mesuré jusqu’ici, c’est le degré d’ingénuité de Jordan Bardella. Le cador se révèle être un junior, et son « livre de témoignage », un vulgaire rapport d’étonnement. La politique pour Bardella se résume à la trajectoire personnelle de Bardella en politique. Rien d’autre.
Qui a déjà atterri sur ses réseaux sociaux ne sera pas surpris : cette forme naïve de mise en valeur de soi était déjà sensible dans sa communication. Petit exercice d’application : donnez un smartphone à Jordan Bardella, le même à François Ruffin, et demandez-leur de parcourir le pays : l’un reviendra avec un film social, tourné à l’iPhone ; l’autre, avec une galerie de selfies, du type : « Jordan à la campagne » ou « Jordan en meeting ».
La différence entre une gauche populaire et une extrême-droite qui se prétend l’être se trouve ici résumée : la première utilise l’image pour faire bouger les lignes et les représentations, rendre visibles les invisibles, donner la parole à ceux qu’on n’entend pas, redéfinissant ainsi qui a la compétence pour voir et la qualité pour dire ; la seconde ne mobilise la puissance des images qu’à des fins étroitement personnelles. Les Français ? Oubliés. Dans ce livre, ils sont littéralement absents.
Tout juste sont-ils des masses indéterminées d’arrière-plan, dont la fonction instrumentale est d’exacerber les émotions de l’auteur : « Près de 6 000 personnes sont présentes dans la salle aux allures de chaudron » ; « Le bain de foule me galvanise ». Les électeurs du Rassemblement National méritaient peut-être mieux que d’être réduits au statut de décorum …
Même chose pour la France : le livre en parle excessivement peu. Le mot « France » est présent, mais pas la chose : chez Bardella, elle demeure une abstraction, un gimmick, une sorte d’esprit dont les mânes peuvent être invoquées de temps à autre – c’est un élément de discours, mais certainement pas un espace, une histoire, une idée. Géographiquement, en dehors de la Seine-Saint-Denis, c’est natio incognita. « La ruralité n’est pas mon environnement d’origine » reconnaît-il volontiers, en évoquant les Gilets jaunes. Faute avouée, à demi-pardonnée. Mais pourquoi s’entêter à en parler quand même ? « J’aime cette France, affirme-t-il crânement. Elle me rappelle mon enfance et les week-ends à Charly-sur-Marne dans l’Aisne, chez ma tante » (sic). On croirait un jeune diplômé d’école de commerce bullshitant un entretien d’embauche, gonflant démesurément son CV pour masquer son inexpérience. Du type : « Je connais bien l’Asie du sud-Est » (j’ai été à la Full Moon Party l’été dernier). On te voit, Jordan.
Fayard m’a tuer
Ainsi, plus Bardella parle de lui-même, et plus on est frappé par cette étrange vacuité de l’être. D’où le mystère que constitue sa trajectoire fulgurante. Pour l’expliquer, on a souvent évoqué la qualité de son entourage, notamment ces jeunes loups de la droite identitaire rencontrés dans les soirées fafs de la « rue des canettes » (chapitre 11). Or de ce point de vue, le livre constitue un sacré aveu de faiblesse, au point qu’on serait tenté de conseiller à l’auteur de se séparer au plus vite de ceux qui l’ont accompagné dans son projet d’écriture. Car si le livre n’est pas spécialement mal écrit, il est, en revanche, incroyablement mal édité !
C’est simple : l’opus tant annoncé cumule à peu près toutes les erreurs d’édition qu’un primo-auteur chercherait légitimement à éviter.
La construction du livre, d’abord : elle est cha-o-tique ! Plutôt cocasse, pour l’autoproclamé « parti de l’ordre ». Dans ce type de livre personnel, l’alternative porte souvent entre deux options : faut-il opter pour une entrée chronologique (l’histoire de ma vie, de ma naissance à aujourd’hui) ou thématique (mes joies, mes luttes, mes peines) ? Manifestement, l’éditeur a choisi la pire solution – ne pas trancher. Résultat : c’est le bordel.
Le récit est tout sauf linéaire et emprunte des trajectoires chronologiques qui défient les lois de l’espace-temps. Avant, arrière, longtemps avant, aujourd’hui, demain, hier : d’un chapitre à l’autre, et parfois au sein même d’un seul chapitre, la réflexion sautille sans la moindre progression temporelle logique.
Au milieu de cette ZAD temporelle, quelques entrées thématiques s’efforcent d’asseoir un tant soit peu la réflexion, comme « Un génie si Français » (chapitre 17), sorte d’envolée à-la-Philippe-de-Villiers sur le wokisme, Notre Dame de Paris ou les Jeux Olympiques (mais en plus mal écrit), ou encore cet étrange dernier chapitre consacré à « Marine », celle à qui il doit tout et qu’il continue de vouvoyer « avec déférence, encore aujourd’hui ».
Mais ces pauses bienvenues n’interrompent guère le tour de manège : immédiatement après, on revient au soir de l’élection européenne, on enchaine sans transition avec un flashback sur son adolescence, pour se reprojeter dans le futur. Que Jordan Bardella ait un cerveau qui fonctionne en zapping mémoriel, ou qu’il ait noté des idées en vrac sur son application Notes, c’est une chose ; mais qu’un éditeur ne l’aide pas à mieux structurer son propos, à ce niveau d’enjeux, cela dépasse l’entendement.
Qu’en déduire sur l’entourage de Jordan Bardella ? Soit aucun de ses relecteurs n’a repéré les défauts d’architecture, ce qui serait la preuve qu’il y a de sacrés trous dans la raquette dans l’équipe Bardella. Soit personne n’a osé souligner le problème, renonçant à le convaincre de revoir sa copie, de peur de déplaire au chef. Incompétence ou couardise : dans les deux cas, c’est inquiétant pour lui.
Les répétitions, ensuite. Elles sont normalement la marque de fabrique des livres auto-édités, le rôle de l’éditeur consistant précisément à éviter de retrouver les mêmes histoires, les mêmes anecdotes, les mêmes réflexions dans des chapitres différents. Ici, elles sont légion. Le lecteur apprendra par exemple, au chapitre 11, que la station de métro près de laquelle Jordan Bardella a longtemps vécu, « située sur la ligne 13 », n’est qu’à « vingt minutes du centre de Paris », ce qui sera confirmé au chapitre 18, en précisant cette fois-ci que l’auteur ne vivait qu’à … « dix-sept minutes en métro de la station Champs-Élysées-Clemenceau ». « J’ai bien connu cette ligne 13 » ajoute-t-il encore : désormais, nous aussi. Relevons quelques marronniers, dont la « mention Très Bien » au BAC (chapitres 10 et 16), ou encore quelques banalités assénées comme des révélations, du type « la politique est un sacerdoce », répétées à pas moins de trois reprises, dans trois chapitres différents. Franchement, personne ne relit les épreuves, chez Fayard ?
Dernier défaut d’édition, et non des moindres : l’absence de tout lissage dans le style. Personne n’en voudra à Jordan Bardella de ne pas avoir écrit son livre tout seul (voire pas écrit du tout), ce ne serait ni le premier, ni le dernier homme politique dans ce cas. Mais la moindre des choses, côté éditeur, c’est de faire son possible pour que cela ne se voit pas ! À vue d’œil, ses plumes sont des mâles blancs de plus de cinquante ans : s’ils s’étaient mis 30 secondes dans la peau d’un jeune de 29 ans, ils n’auraient pas parlé de « poltronnerie » ou de « pantalonnade » : plus personne ne parle comme ça depuis un demi-siècle.
Dans certains articles de presse ayant annoncé la parution du livre, on avait appris qu’une équipe de choc avait été constituée par Fayard pour aider son « auteur » – un journaliste du service public, un historien…
Ce qui est étonnant, c’est qu’à la lecture, on peut repérer à l’œil nu que plusieurs plumes différentes sont intervenues sur le texte. Il y a le commissaire politique, qui veille à ce qu’on parle bien des membres du RN, avec les bons adjectifs qui caressent dans le sens du poil ; il y a le croqueur de portrait qui, à intervalles réguliers, lâche une perfidie bien dosée sur tel ou tel adversaire politique ; il y a le haut fonctionnaire, qui sort un propos incroyablement technique sur le nucléaire ou la réforme fiscale, au milieu d’un développement qui n’a rien à voir avec la choucroute ; et puis, c’est mon préféré, il y a le romancier : c’est lui qui trouve les bonnes formules, comme lorsqu’il qualifie Saint-Denis de « paradis paradoxal de [son] enfance ». C’est lui, aussi, qui écrit tous les lancements de chapitre, avec des envolées lyriques du genre : « 8h30. La nuit fut courte. J’ai fermé l’œil aux environs de 4 heures du matin. À peine le temps de souffler. J’avale rapidement un café et fais exceptionnellement l’impasse sur le petit-déjeuner ».
Cette pluralité des auteurs était si flagrante que, tout au long de la lecture, je me suis amusé à surligner d’une couleur différente chaque plume : le commissaire politique en bleu, le haut-fonctionnaire en jaune, le romancier en rose … Et en relisant mes notes, j’ai compris : ce livre, c’est un gigantesque Word partagé, chacun y allant de ses ajouts dans son coin, sans aucune contrainte. Mais là où le bât blesse, c’est qu’il semble que l’éditeur, lui, se soit contenté, pour tout travail, de cliquer sur « Accepter toutes les modifications et arrêter le suivi ». Paresse ou sabotage ? Franchement, si j’étais Bardella, je changerais de crémerie pour mon prochain livre…
Salade grecque
L’ensemble du livre de Bardella laisse profondément perplexe. Alors que le Rassemblement National n’a jamais été aussi proche du pouvoir, le parti n’a jamais été incarné de façon aussi flottante. Sans doute est-ce précisément cette indétermination qui a permis jusqu’ici à Jordan Bardella de se hisser parmi les personnalités politiques préférées des Français. Mais dès lors, quelle nécessité avait-il de publier un tel livre de mémoire : ne sort-on pas de l’ambiguïté qu’à son détriment ? Mon sentiment, c’est que ce livre marque un tournant : c’est une condensation. En produisant ce texte, Jordan Bardella opère un changement d’état – il quitte l’état gazeux pour un état solide.
À l’oral, son aisance et sa répartie permettaient de masquer ses failles : une pirouette, un bon mot, un sourire, et il pouvait s’extraire d’une question délicate, qui pointait une approximation ou une incohérence – ça, c’était l’état gazeux. Les écrits, eux, restent : la relecture à froid est impitoyable. À l’état solide, le non-respect du principe de non-contradiction devient difficile à tenir : défendre une chose et son contraire deux pages plus loin, cela se voit. Avec Ce que je cherche, les failles du bardellisme s’exposent au su et au vu de tous, avec, à terme, le risque de voir ses inconséquences, pour ne pas dire son insignifiance, lui exploser à la figure.
Car c’est peut-être là qu’est la véritable révélation du livre. En voulant lever le voile, Jordan Bardella nous a exposés à la persistance de son vide. Dans la littérature, il y a deux types de personnages : d’un côté, ceux qui sont « pleins » dès le départ. Tyrans, sorciers ou inspecteurs : dotés d’entrée de jeux de traits de caractère et de pouvoirs bien installés, tout le récit consistera à progressivement « évider » ces personnages, à les exploiter comme de véritables banques de situations et d’actions. De l’autre côté, il y a des personnages qui, vides au départ, vont se voir petit à petit « remplir » par le récit, au gré des évènements et du déroulement de l’intrigue. Jordan Bardella, lui, correspond à une troisième catégorie de personnages, rarissime : vide au départ, il se retrouve, après moults péripéties, vide à l’arrivée.
Qu’il semble loin, dès lors, le temps où le mouvement nationaliste pouvait s'enorgueillir de s’appuyer sur une doctrine, des auteurs, un corpus de pensée. Citer Napoléon en exergue (« Ce que je cherche avant tout, c’est la grandeur : ce qui est grand est toujours beau ») ne suffit pas à masquer la rupture profonde que Bardella introduit dans la tradition politique dont il se veut le porteur.
Preuve éclatante, la drôle de justification de sa quatrième de couverture : « Pourquoi ai-je choisi une photo à Athènes, non loin de l’Acropole, pour achever ces confessions ? » demande-t-il au lecteur. On s’attend alors à un long développement sur les origines de la grandeur de l’Europe, sur l’invention de la démocratie populaire, sur la nécessaire défense de sa civilisation menacée ... Mais non, chez Bardella tout est bien plus terre-à-terre : « Parce que cette colline est belle et grande. » Alors, on referme le livre pour la contempler, tout de même, cette belle et grande colline. Déception : elle est surtout petite et floue, reléguée à l’arrière-plan. En grand et en net, que retrouve-t-on au premier plan ? Une nouvelle photographie de Jordan Bardella, en costard-cravate, téléphone vissé à l’oreille, façon Men in Black, dans une pose qui l’apparenterait davantage à un membre du service de protection d’un président américain qu’à un leader nationaliste européen.
C’est à ce titre que ce livre importe : comme un symptôme important de l’évolution de l’extrême-droite. Aux portes du pouvoir, on découvre que ce Rassemblement National – en la personne de son dirigeant – a un rapport à la politique considérablement étriqué. Il n’est plus question de bataille culturelle ou de combat d’idées : ici, la politique est l’affaire d’une petite clique qui cherche à trouver sa place.
Dans son texte, Jordan Bardella se présente comme un homme politique incapable de donner à voir autre chose que son propre kif, son autosatisfaction de connaître une vie peu ordinaire, sa propre jouissance d’épouser un rythme de vie effréné.
On a enfin compris « ce que cherche » Jordan Bardella : ce n’est pas à enrayer le déclin français ou à se faire le porte-voix de la « France des oubliés », mais à s’accomplir en tant qu’individu. C’est un « je » que cherche Bardella, rien d’autre : pour lui, la politique est une voie d’épanouissement personnel comme les autres – au même titre que le yoga, le jardinage ou la couture.
En rupture avec la tradition de sa famille politique, Jordan Bardella n’entend évidemment pas se sacrifier pour la France – quelle idée – mais il attend de la France qu’elle le serve, et, en l’occurrence, qu’elle serve ses ambitions personnelles. Voilà à quoi sert la politique pour Jordan Bardella : à changer de vie, la sienne, plutôt qu’à changer la vie, celle des autres.
Traditionnellement, chez les réactionnaires, on moque l’égocentrisme jouisseur de l’individu progressiste post-soixante-huitard – il suffit d’ouvrir n’importe quel roman de Michel Houellebecq. À refermer le livre de Jordan Bardella, on se dit que certains défauts de l’époque sont peut-être plus universellement répartis.
Surtout, on se dit que le culte de la jouissance, de la vie sans entraves, des droits sans devoirs, des gains sans travail, des acquis sans expériences, de la prééminence du « je » sur le « nous » … bref, que tout ce qui préfère la « glorification du moi » au « don de soi » ne se situe finalement pas du côté politique que l’on veut nous faire croire.