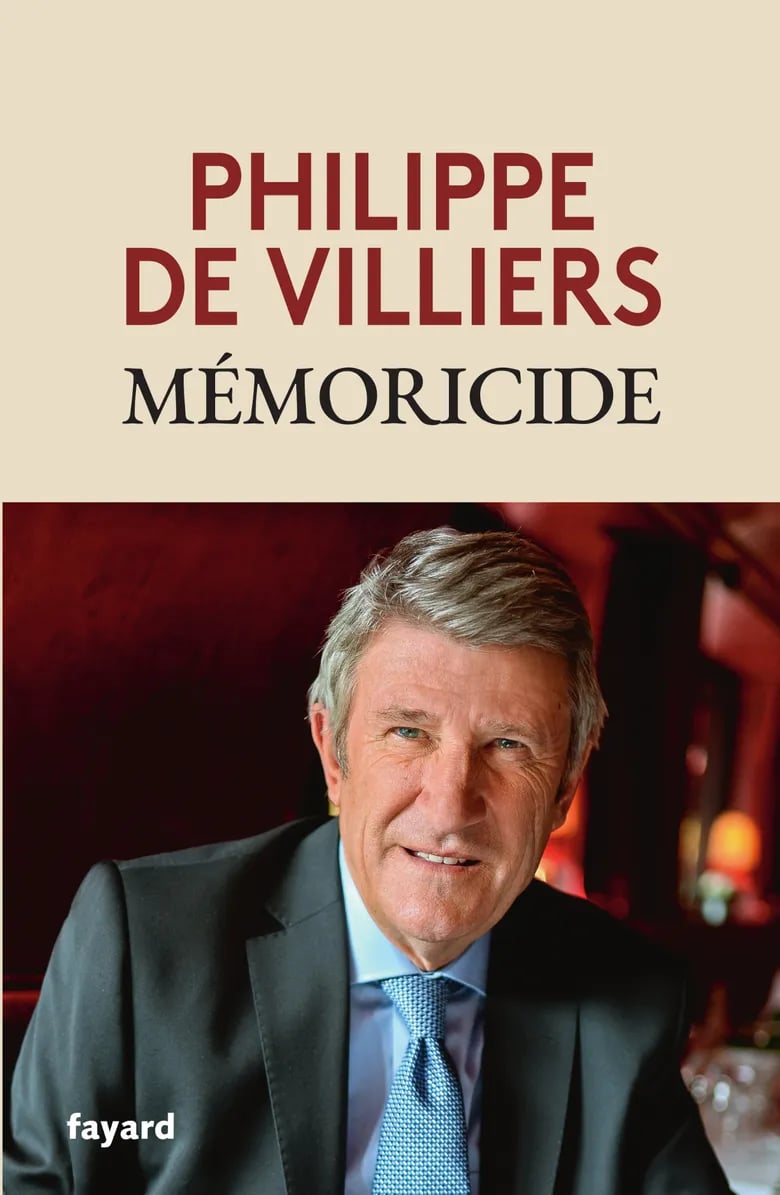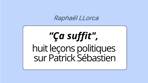Philippe de Villiers, le premier des fragiles
Après la défense de l’introuvable « génocide vendéen », après avoir raconté des histoires à dormir debout sur la construction européenne (J’ai tiré sur le fil du mensonge et tout est venu, Fayard, 2019) ou sur la pandémie de Covid-19 (Le jour d’après, Albin Michel, 2021), le pater familias de la pensée réactionnaire reprend la plume.


Privé de tout mandat électif, Philippe de Villiers aura eu le droit à une campagne d’affichage dans les gares, lui. Après la défense de l’introuvable « génocide vendéen », après avoir raconté des histoires à dormir debout sur la construction européenne (J’ai tiré sur le fil du mensonge et tout est venu, Fayard, 2019) ou sur la pandémie de Covid-19 (Le jour d’après, Albin Michel, 2021), le pater familias de la pensée réactionnaire reprend la plume, et fait paraître Mémoricide aux éditions Fayard (384p., 24,90€). Bénéficiant d’une campagne de promotion XXL, le livre caracole en tête des ventes. Il fallait donc s’y pencher.
À tout seigneur, tout honneur. Philippe de Villiers est sans doute le premier à l’extrême-droite à avoir mis en pratique les thèses gramsciennes de la guerre culturelle. Son combat « métapolitique » forme un continuum : des parcs à thème aux médias bolloréens, en passant par les étals des librairies. C’est donc lui qu’il fallait lire en priorité pour saisir l’architecture mentale, les références littéraires et historiques, le système d’argumentation, bref, la vision du monde de cette nébuleuse réactionnaire qui avance triomphalement. D’où ma lecture attentive de Mémoricide, que j’ai menée comme une quête, à la recherche de ce que ce livre avait d’intéressant à nous apprendre sur la pensée réactionnaire.
Vieux tubes
D’emblée, un constat s’impose : le Chevalier fatigue. Le fanion déchu, la monture engourdie, l’armure grinçante : c’est tout le discours qui a pris un gros coup de vieux. Ses attaques contre la « médiacratie », « Schengen », le « Cercle de la raison », ou les « ficelles de la gouvernance mondiale » sonnent terriblement désuet. Franchement, est-ce bien raisonnable, en 2024, de continuer de prendre Jacques Attali comme principale tête de turc ? La charge virulente du cavalier d’hier ressemble au dernier tour de piste d’un cow-boy de music-hall fatigué. L’éternel couplet de « l’effondrement de la société millénaire », inlassablement répété au cours de ses 26 précédents ouvrages, en devient lassant. Mêmes refrains prévisibles sur l’échec du « collège unique de Giscard », « mai 68 » ou la mort de « l’expression libre ». Oui, on sait : « Il n’y a plus de Charles Martel !” ». L’effet est d’autant plus déroutant que l’auteur s’épargne tout développement argumenté. Langueur du vainqueur ? Est-ce parce que ses thèmes sont dans l’air qu’il ne prend même plus la peine de les développer ? Une autre explication : à coup sûr, nous ne sommes pas le public visé. Ses lecteurs, eux, en comprennent immédiatement la signification. Ce sont des repères, des balises que l’auteur pose à intervalle régulier pour recréer rapidement l’ambiance réactionnaire que ses fidèles affectionnent. Soit l’impressionnante preuve du lien qu’il a su patiemment créer avec son public. Comme Mylène Farmer en concert, Philippe de Villiers peut se contenter de lancer l’instru : tout le stade est capable de chanter ses vieux tubes a capella. Chapeau, l’artiste.
On l’aura compris, ce n’est pas dans Mémoricide qu’on trouvera des idées nouvelles. Là où c’est intéressant, c’est que l’ouvrage est une sorte de tableau expressionniste du paysage mental de Philippe de Villiers. Une sorte de compilation de ses meilleurs moments, quelque part entre le bêtisier et le best-of. L’effet playlist entraîne toutefois un inconvénient, sur le fond. Mis bout à bout, l’énumération de pas moins d’une dizaine de « tournants » historiques finit par poser question : si c’était mieux avant, c’était quand, « avant » ? Avant Schengen ? Avant la « grande bascule liturgique » de Vatican II ? Avant le « point de bascule » de l’accord de Marrakech du 15 avril 1994 ? Ou avant 1793 ? L’aveu implicite est éclatant : « avant » est un point de fuite, pas une borne chronologique ; un référentiel imaginaire, certainement pas temporel. « Avant » n’existe pas vraiment : c’est un contrat de lecture, une convention, comme lorsqu’au théâtre un acteur déclare que la scène est un bateau. Ce n’est pas vrai, mais on fait tous semblant d’y croire, pour les besoins de la représentation. Et Dieu sait qu’en matière de spectacle vivant, Philippe de Villiers en connaît un rayon.
Mémoricides contradictoires
Soyons honnête : il y a bien une idée neuve. Celle qui donne son titre à l’ouvrage, le mémoricide. Le terme évoque ce chapelet de concepts que la droite radicale aime à forger (« francocide », « vélocide ») : ici, il désigne une politique visant à effacer les traces de la mémoire d’un peuple et de sa culture. L’auteur présente la France comme la victime d’ « une ablation de sa mémoire, d’une spoliation, d’une péremption de ses souvenirs » et ajoute : « J’aurai consacré ma vie à combattre deux mémoricides : le mémoricide français et le mémoricide vendéen ». Restons sur le mémoricide français. À l’étude, l’hypothèse est lestée d’une équivoque gênante. Expliquons-nous.
À le lire, le mémoricide se serait déroulé en deux actes. Le premier remonte à la Révolution française, et son mythe de la « Tabula rasa » qui entendait tout changer : la toponymie, les repères du calendrier, les noms des villes médiévales … C’est à ce moment-là que « la France a perdu sa matrice ». Le second mémoricide correspond à la mise à mort du roman national, vécue comme « un attentat à la mémoire de notre pays ». Ce faisant, explique l’auteur, « notre peuple perd ses défenses immunitaires, identitaires ». Pire : « on a amputé toute une population de l’acquis le plus précieux des vieux peuples, le droit à la continuité historique ». Voilà pour la thèse, condensée en quelques pages : le problème, c’est qu’elle rend intenable la position politique de Philippe De Villiers. Car ce « roman national » dont il regrette la disparition, c’est précisément l’histoire de la nation que les libéraux et les républicains du XIXe ont inventé pour remplacer l’histoire traditionnelle de la France d’Ancien Régime. Autrement dit, un aristocrate conséquent, déplorant l’effacement de la mémoire de la France éternelle avec ses monarques, ses ordres, ses Églises et ses corporations trouverait un motif inouï de réjouissance dans l’effacement de ce roman national qui a tenté de la remplacer en glorifiant ce que son courant réactionnaire abhorre par ailleurs : la souveraineté populaire, la sortie du monde religieux, la démocratisation de la société. Depuis un point de vue réactionnaire sérieux, il ne peut pas y avoir de double mémoricide. Soit l’histoire réelle de la France est celle de la « France éternelle », et alors l’effacement du « roman national » est une bénédiction. Soit, c’est le « roman national » qui disait la vérité historique de la France, mais alors la « France éternelle » méritait de tomber dans l’oubli. « France éternelle » ou « roman national » ? Il faut choisir, camarade.
Au regard de la contradiction intrinsèque de la seule vraie idée avancée par le livre, on se dit que l’auteur a bien fait de ne pas les multiplier ! Car en réalité, l’essentiel est ailleurs. Dans les 380 pages restantes, il est question d’autre chose, de choses bien plus intimes : de l’auteur lui-même, de ses souvenirs, de ses failles, de ses souffrances. La réalité, c’est que Mémoricide n’est pas un essai politique sur la mémoire d’un pays : c’est une autobiographie sur la mémoire blessée de Philippe de Villiers.
Roman familial
Contre toute attente, c’est de sa vie qu’il s’agit. C’est d’elle qu’il se remémore. Et là – surprise – le texte nous dévoile un hypersensible qui brise enfin l’armure : « J’ai souffert » écrit-il. À qui sait les entendre, l’homme multiplie les appels à l’aide. Il dévoile les nuits agitées : « Souvent, confesse-t-il, je me réveille en sursaut la nuit, oppressé par une angoisse, bousculé par des questions vertigineuses ». Plus loin : « Quand, en m’endormant, je repense à la Rue Saint-Guillaume, je cauchemarde. » Chemin faisant, le lecteur se rapproche de ce qui le tourmente : « Je vis avec une brûlure, une cicatrice ouverte » écrit le polémiste de CNews, qui va enfin tomber le masque. Car le trauma est profond : il faut en passer par l’écriture pour « remonter le courant, comme le saumon dans la Loire boueuse des crues hivernales ».
Trauma de l’enfance ? Assurément, non. « Mon père était aristotélicien et thomiste », apprend-on – la chose est pour le moins intimidante, mais sans doute pas traumatisante pour autant. Sa mère, quant à elle, ne semble qu’amour et sagesse. Chaque soir, « au moment du baiser de la nuit », elle lui glissait à l’oreille : « Une seule mésange te fera aimer tous les oiseaux, un seul clocher toutes les églises, un seul bocage tous les paysages de la France ». Enfance heureuse, famille aimante. A la rigueur, tout juste notera-t-on une propension à manquer de recul sur ce qui constitue son “roman familial”. L’auteur semble idéaliser sa famille, confondre histoire et mythe. Il rappelle à maintes reprises qu’elle était « l’une des plus anciennes et les plus illustres du Cotentin ». Il est question d’un lointain aïeul, Pierre le Jolis, parti en 1040 à la conquête du royaume de Naples et de Sicile. Certains suivront en Angleterre l’aventure de Guillaume le Conquérant, d’autres prendront part aux Croisades. La légende raconte même que le grand-père de Philippe de Villiers aurait reçu une balle en pleine poitrine ; tombant de cheval, il aurait crié, dans un dernier souffle : « Vive la France ! ». C’est beau comme du Michelet : son environnement familial est définitivement hors de cause.
Micro-agressions
Non, la Blessure vient d’ailleurs. Elle vient du regard que la société a posé sur lui. Elle vient de ses difficultés à vivre avec son stigmate social, celui d’appartenir à … l’aristocratie. Philippe de Villiers trouve aujourd’hui les mots pour décrire son « destin de souffre-douleur archétypal ». Discriminé en raison de ses origines familiales, il s’épanche : « j’étais un lépreux », ou encore « un paria, un réprouvé ». Alors, les souvenirs douloureux se bousculent. Cette rentrée à l’ENA, en décembre 1974, dont il ne retient qu’une profonde humiliation : ce sentiment d’être « toisé par les vertébrés supérieurs du système qui observaient un spécimen de vertébré inférieur, juste sorti des collections du muséum de Buffon ». L’entrée au Ministère de la Culture, où, rebelote, le voilà tel « un huron au Palais-Royal, destiné à l’errance entre les Colonnes de Buren ». Au creux de sa plume, l’auteur impose une voix qu’on avait jusqu’alors injustement étouffée : tout privilégié qu’il ait pu être perçu, l’aristocrate a éprouvé les mêmes difficultés d'intégration que le commun des mortels. Son arrogance n’est qu’une façade, sa distance un système de défense : Philippe de Villiers est comme tout le monde, il aurait voulu qu’on l’accueille, il aurait voulu qu’on l’aime.
La honte doit changer de camp : Philippe de Villiers va donc nommer ses bourreaux. Les progressistes d’abord. À chaque étape de sa vie, ils l’ont « frappé de ridicule ». Il se remémore : « on raillait mes créations en Vendée, on se moquait des ‘feux de joie’ du Puy du Fou, de la ‘kermesse au long cours’ du Vendée Globe, on me racialisait, on m’ethnicisait ». C’est bien simple, résume-t-il : « Pendant cinquante ans, on m’a demandé de porter une crécelle aux portes de la cité ». La corporation des journalistes, ensuite : ce sont eux, ses pires harceleurs. Voyez plutôt la cruauté du procédé : « Les articles commençaient tous avec la même entame : Monsieur le Vicomte, sur ses terres ». Petitesse. « J’étais décapité tous les jours ». Acharnement. Ces ricaneurs ont longtemps moqué la chevalière qu’il portait à sa main gauche – celle qui signifie tant pour lui, scellant son inscription dans une longue histoire familiale et nationale. Emporté par tant de souffrances contenues, il ose même : « On cherchait un signe distinctif pour qualifier l’homme de l’espèce que j’étais. Comme jadis on eût mis la focale sur une étoile de David. »
Fermons les yeux sur l’indécence de cette dernière comparaison. « Tout ce qui est excessif est insignifiant » disait Talleyrand ; là, dans cette plainte, il y a au contraire quelque chose de très significatif. Car la confession qu’hasarde ici Philippe de Villiers est d’une remarquable audace. Quel véritable aristocrate, se conformant aux normes millénaires de sa famille, de son clan, se serait soucié de l’avis des cool kids, des journalistes, des gens du monde, et même de l’opinion publique ? Ce que le Vendéen confesse finalement, c’est qu’il aura été un moderne comme les autres, soucieux de l’avis, mieux, de l’approbation d’une société, d’un pays, d’une élite – et l’état de délabrement qu’il leur prête ne l’aura pas empêché de souffrir de leurs moqueries.
L’homme a beau proclamer ensuite fièrement – « Je suis un héritier… Je parle comme un héritier, je pense comme un héritier, je célèbre un héritage, un legs spirituel dont je prétends être un humble débiteur et un simple passeur. » – le lecteur ne peut plus être dupe. La blessure confiée remplit son office. On sait désormais que ses chevaleries n’auront été que des refuges où soigner sa blessure. La contradiction lui explose à la figure : l'héritier n'est qu’un contemporain. Celui qui se réclame de la longue chaîne des temps, de la France éternelle, des traditions et des ordres immuables, ce même homme reste traumatisé, à soixante-quinze ans passés, par ce qu’il y a de plus hypermoderne : par les petites vexations, les petites discriminations, les petites moqueries, et cette immense faille narcissique qu'elles ont ouverte en lui. Un antimoderne mépriserait les moqueries du siècle ; elles l’ont atteint. Un aristocrate honnirait le discours de la victimisation ; lui, il s’y vautre, et grossièrement. Ainsi donc, le premier des réactionnaires cachait le premier des fragiles.
Relecture
Mais dès lors, depuis ce traumatisme originel, c’est toute la vie et l’ensemble du projet politique de Philippe de Villiers qui se donne à lire sous un nouveau jour. Si son véritable moteur n’est pas politique mais névrotique, pas mémoriel mais égotique, se pourrait-il que le revival réactionnaire français se soit fondé sur … une faille narcissique ? Le désir de permanence, la défense des traditions, la lutte contre l’effacement du peuple français … doit-on aller jusqu’à comprendre que tout ceci ne serait qu’un conservatisme-écran, non pas construit sur un solide système de valeurs et de convictions mais engendré par un égo blessé dans son désir de reconnaissance individuelle ? L’aventure du Puy du Fou serait ainsi celle de la construction d’un gigantesque safe space : un espace créé de toutes pièces pour que le petit Philippe, rejeté de la capitale, puisse se sentir intégré, enfin. La fonction même de la rhétorique de « l’avant » doit, elle aussi, être réexaminée : ce qui était mieux avant, c’est tout ce qu’il y avait avant la Blessure - d’où son côté flottant, subjectif, fonctionnellement indéterminé.
À son corps défendant, Philippe de Villiers expose au grand jour le ressort réel de son grand projet politique : non pas le souhait du retour à la France éternelle, mais la demande d’une reconnaissance, le besoin d’une intégration à la France la plus contemporaine. En réalité, ce ne sont pas les Églises, les ordres, et le Roy qui ont manqué à Philippe de Villiers : c’est un défaut d’inclusivité de la société française de la fin du XXe siècle. Ce qui a manqué à Phillipe de Villiers, c’est précisément ce « néoprogressisme » qu’il pourfend avec tant d’animosité, et qui a pourtant le mérite d’œuvrer pour faciliter l’intégration de toutes les individualités dans tous les groupes et les espaces sociaux. Si on pousse la réflexion jusqu’au bout, on touche à l’indicible : contrairement à ce qu’il répète à longueur de journée, Philippe de Villiers ne souhaite pas la disparition du « wokisme », bien au contraire ; au fond de lui-même, il aurait secrètement souhaité une sorte d’extension du domaine de la lutte contre les discriminations, jusqu’à celles vécues par les aristocrates. À tout le moins, ce dont aurait eu besoin Philippe de Villiers à son arrivée à Paris, c’est de bénéficier de ces « réseaux gauchistes » qui ont aidé des générations entières de jeunes, montés à la capitale et découvrant qu’ils n’en avaient pas les codes. Cela nous aurait collectivement épargnés bien des effets politiques collatéraux.